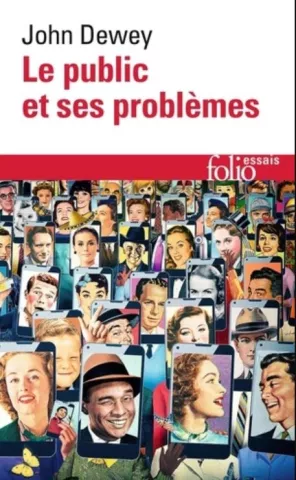
« Penser, c’est réapprendre à voir », disait Camus. Mais comment renouveler le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure ? La lecture est une source de découvertes intemporelles qui ouvrent les yeux sur de vastes horizons de réflexion. Il est ainsi des livres qui offrent une perspective éclairante et qui permettent de réfléchir aux évènements que nous traversons. C’est le cas de l’ouvrage de John Dewey, psychologue et philosophe américain de la fin du 19e siècle, intitulé Le public et ses problèmes, paru en 1925.
Lors de la Matinale organisée au mois de novembre, notre invitée Joëlle Zask, philosophe et maître de conférences à l’université d’Aix Marseille, avait déjà évoqué cette grande figure intellectuelle américaine, dont elle avait été la première à traduire les écrits en France.
La réflexion menée ne date pas d’hier et pourrait paraître très largement dépassée. Et pourtant, elle semble d’une actualité flagrante, au regard de la crise majeure que subit aujourd’hui la politique, depuis la dissolution de l’Assemblée en juin 2024 jusqu’à la dernière démission du Premier ministre au début du mois de septembre 2025.
En quoi cet ouvrage de Dewey peut-il nous permettre renouveler le regard que nous portons sur cette crise profonde ?
La politique comme expérimentation
Dès les premières pages, le point d’accroche est posé : « La formation des Etats doit être un processus expérimental […] l’expérimentation doit toujours être reprise ; l’Etat doit toujours être redécouvert ». En définissant la politique comme une expérience, Dewey insiste sur son caractère fondamentalement dynamique : loin de se réduire à la gestion des affaires courantes ou à un modèle à appliquer, c’est au contraire une activité en train de se faire, continuellement reprise.
Mais qui en sont les acteurs ? Les citoyens ou les élites dirigeantes ?
Le pouvoir des citoyens
L’ouvrage Le public et ses problèmes naît d’une polémique opposant deux grands intellectuels américains de l’époque, autour de la question du pouvoir des citoyens.
Le premier, Lippmann, écrivain et journaliste, dénonce l’ignorance du citoyen ordinaire et l’irrationalité irrépressible du jugement individuel. Il conclut : « Nous devons abandonner l’idée que le peuple gouverne ». Il est à l’origine de l’expression « la fabrique du consentement » désignant une nouvelle forme de propagande qui permet aux élites dirigeantes éclairées d’amener l’opinion publique à adhérer pleinement aux décisions prises.
Le second, Dewey, philosophe et psychologue, cherche au contraire à restituer aux citoyens (qu’il regroupe sous le terme de « public ») le pouvoir et les compétences dont ils ont été privés et s’interroge : si tous les citoyens sont censés de par la loi pouvoir participer à la res publica (littéralement la chose publique), pour autant y participent-ils réellement ? Malheureusement, non, estime Dewey, qui évoque la figure du « lost individual » (« individu perdu ») caractéristique de son époque, dont la personnalité est « désintégrée », ignorant le monde et ses conditions de sens et incapable d’influer sur sa propre vie. Dès lors, Dewey va concentrer toute sa réflexion sur les conditions de possibilité de participation du public (ensemble des citoyens) à l’organisation d’un changement social volontaire. Pour lui, ce public doit toujours être en reconstruction, à travers une expérimentation continue, qui est aux fondements de la démocratie. Il doit se réinventer continuellement.
Cette polémique ne trouve-t-elle pas un écho assourdissant au 21e siècle ? Entre « fabrique du consentement », « individu perdu » et expérimentation continue renvoyant à la démocratie participative, l’ouvrage de Dewey, si ancien soit-il, évoque pourtant tous les enjeux de la démocratie contemporaine.
L’éclipse du public
Dewey met en avant le potentiel d’action dont dispose le public (ensemble de citoyens), tout en s’étonnant de son inaction.
Quelles sont les raisons de l’éclipse du public ? Pourquoi n’a-t-il pas réussi, malgré les espoirs donnés par la démocratie, à se trouver, à s’identifier, pour jouer pleinement son rôle ?
Dewey identifie quatre causes principales. D'abord, il dénonce l’incohérence du public démocratique, qui « est encore largement incohérent et inorganisé ». Puis il déplore l’impuissance des individus : « Les hommes sentent qu’ils sont pris dans un flot de forces trop vastes pour qu’ils les comprennent ou les maîtrisent. La pensée est immobilisée et l’action, paralysée ». Par ailleurs, il pointe du doigt le renoncement des citoyens, plus intéressés par les divertissements que par les affaires publiques : « L’augmentation du nombre et de la variété des divertissements, ainsi que leur faible coût, représente une diversion puissante par rapport aux préoccupations politiques ». Mais il estime que le problème est avant tout d’ordre intellectuel : « le problème du public […] dépend de l’intelligence et de l’éducation ».
Les leviers d’action du public
Face à ce diagnostic, Dewey identifie plusieurs leviers d’action pouvant permettre au public de développer un véritable potentiel d’action.
D’une part, la communication constitue pour lui le fer de lance d’un public réellement opérationnel. Mais encore faut-il préciser ce qu’on entend par communication : « […] le besoin essentiel est l’amélioration des méthodes et des conditions du débat, de la discussion et de la persuasion ».
D’autre part, la connaissance est indispensable à toute action efficiente, et ne doit pas être réservée à une élite. Dewey prône ainsi de lutter contre la loi de l’expertise et la confiscation du pouvoir de décider. « Une classe d’experts est inévitablement tellement coupée des intérêts communs qu’elle en devient une classe avec des intérêts privés et une connaissance privée, ce qui, dans les affaires sociales, ne représente aucune connaissance du tout […] Tout gouvernement par les experts dans lequel les masses n’ont pas la possibilité d’informer les experts sur leurs besoins ne peut être autre chose qu’une oligarchie administrée en vue des intérêts de quelques-uns ». Pour sortir de cette loi de l’expertise, il faut former et éduquer, mais dans la perspective de développer un esprit critique, car « ce qui est requis est qu’elle [la masse] ait l’aptitude de juger la portée de la connaissance fournie par d’autres sur les préoccupations communes ».
Dewey considère donc que l’éducation doit être placée au cœur du processus démocratique. D’où la question, qui fait le lien avec cette période de rentrée scolaire : Avons-nous pensé l’éducation de nos enfants pour en faire de futurs citoyens, capables de juger par eux-mêmes, en toute autonomie ? Ou notre système scolaire se limite-t-il à former de jeunes adultes conformes aux exigences du marché du travail ?
Une vaste question, qui fera l’objet d’un prochain article … à suivre …

Commentaires
Accepter l'expérience en politique
Merci beaucoup Stéphanie pour cette découverte d’un auteur qui n’était pour moi qu’un nom.
« La formation des États doit être un processus expérimental […] l’expérimentation doit toujours être reprise ; l’État doit toujours être redécouvert ». Je pense que cette idée est particulièrement stimulante. La France fait depuis la dissolution l’expérience -potentiellement bénéfique- d’un parlement sans majorité. Elle progresse (« l’expérience » que tente Lecornu est un progrès par rapport aux deux Premiers ministres précédents) mais on sent bien que les spectateurs (citoyens, journalistes…) ont du mal à changer de grille de lecture.
Accepter l'expérience en politique
Recension très intéressante d'un remarquable ouvrage. On s'aperçoit une fois de plus que les grands esprits prévoient des décennies à l'avance ce que leurs observations leur laisse deviner. Son livre est un tableau saisissant de la France actuelle. Malheureusement, Dewey a inspiré peu de nos politiques. L'immobilisme des "sachants" a entrainé la faillite de l'éducation et la concentration du pouvoir aux mains d'experts toujours choisi parmi les disciples de Lippmann !
Ajouter un commentaire