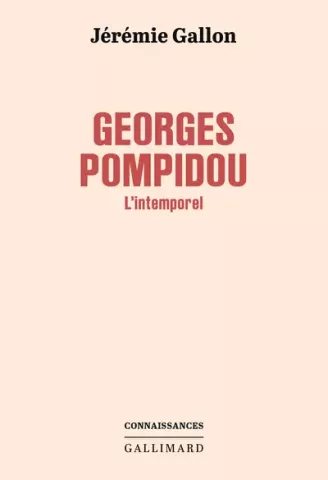
Un nouveau livre publié en mars dernier par Gallimard est consacré à Georges Pompidou. L’auteur, Jérémie Gallon a manqué l’année du cinquantième anniversaire de la mort du second président de la Cinquième République (le 2 avril 1974 ) sans doute parce qu’il a eu besoin de temps supplémentaire pour exploiter son imposante bibliographie
Il en ressort un livre très complet, remarquablement documenté, qui cerne avec une grande précision la riche personnalité de Georges Pompidou et évoque un grand nombre de ceux qui ont travaillé avec lui pour renforcer la France des trente glorieuses.
Et notamment Bernard Esambert, président d’honneur du Club des vigilants dont il fut l’un des fondateurs et le premier président pendant plus de dix ans. A l’Élysée, il fut un des « quatre mousquetaires de Georges Pompidou » avec qui il a industrialisé la France en créant des fleurons qui tiennent encore debout aujourd’hui, malgré les mauvaises décisions, les retour en arrière, et l’absence de vision des politiques industrielles qui se sont succédées depuis 50 ans. Il ne s’agit de rien moins que l’énergie nucléaire, Airbus, le programme Ariane et le TGV. Pendant les cinq années de la présidence Pompidou, le taux de croissance annuel de la production industrielle française a été de 7,5 % !
Le livre évoque aussi Jacques Andréani, qui fut l’un des administrateurs du Club. Georges Pompidou l’avait nommé à la tête de la délégation française qui a fortement influencé la constitution de la « corbeille » des droits de l’Homme de la conférence d’Helsinki lancée en 1973 et son acceptation par Brejnev (qui appréciait Pompidou). On sait que cette initiative contribuera à l’émancipation des pays du bloc soviétique à travers l’émergence de Solidarnosc en Pologne ou de la charte 77 en Tchécoslovaquie.
Le sous-titre du livre « l’intemporel » interpelle. Lecture faite, il parait excellemment choisi car il caractérise la personnalité de Georges Pompidou, sa méthode d’action et ses qualités humaines.
Intemporelle, l’origine familiale de Pompidou : « je suis le fils du Cantal, le fils de Montboudif », village du Cantal, dans les plateaux de Haute Auvergne. « Pauvre et de petite extrace ». Les Pompidou sont de père en fils des ouvriers agricoles jusqu’à la génération de ses grands-parents. Son père et sa mère sont des « hussards de la république ». Voici ce qu’il en dit : « Mon père et ma mère appartenaient profondément à la race française, dure au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l’esprit, aux qualités du cœur ... Si loin que je remonte, je n’ai eu que des leçons de droiture, d’honnêteté et de travail ». Il en retiendra aussi le sens de l’honneur et l’horreur pour la calomnie et la bassesse d’âme.
Intemporel son parcours vers la plus grande réussite : travailleur, exceptionnellement doué, il est vite remarqué par ses professeurs. Il franchit toutes les étapes du cursus honorum de ceux qui n‘ont pas de grande naissance jusqu’à l’entrée à Normale Supérieure (huitième, ce qui le chagrine ; devenu président de la République, il nommera le cacique de sa promotion directeur de l’École) et l’agrégation de lettres (premier sans avoir à travailler beaucoup selon ses professeurs). En khâgne à Louis le Grand, il prend sous son aile un déraciné tenu un peu à l’écart par les autres, Léopold Sédar Senghor. Ils deviennent très amis. Senghor l’appelle son « plus-que-frère ». Ils suivirent des voies parallèles : agrégation, amour des lettres, présidence de la République en 1960 pour Senghor, 1969 pour Pompidou qui lui écrit aussitôt élu : « mon cher Ghor, je suis élu, la bataille a été rude... Nous voici tous les deux chefs d’Etat, quel étrange destin ! ».
Intemporelle son immense culture de fin lettré. Culture classique : premier prix de version grecque au concours général de 1927, admissible à Normale Sup en 1930, admis en 1931. L’École offrait une ouverture d’esprit éblouissante aux jeunes gens les plus doués de leur génération : « nous étions capables de confronter nos points de vue dans tous les domaines ...avec une franchise, un mépris des contingences, une volonté de comprendre et de se faire comprendre ». L’ENA plus tard n’a jamais constitué un tel bouillon de culture. A la banque Rothschild puis à Matignon, et à l’Élysée, il réunira régulièrement ses camarades de Normale Sup.
Il lit avec fureur les auteurs d’horizon et de culture des plus variés et se constitue un panorama intellectuel immense auquel il pourra se référer toute sa vie. Doté d’une mémoire prodigieuse, assoiffé de poésies, il connait par cœur des milliers de vers. Il se les récite pendant des heures en conduisant sa Porsche pour se rendre dans le midi. : la poésie est pour lui un ressourcement spirituel indispensable, un moyen de percer la réalité cachée du monde. Elle éclaire ses décisions.
Sa culture est à la fois profonde et éclectique. Jeune normalien, il achète une édition originale de « la Femme 100 têtes » de Max Ernst et poursuivra avec son épouse Claude qui partageait sa passion une collection qui atteindra 150 œuvres. Il a fréquenté dès ses jeunes années, alors qu’il était un parfait inconnu, Delaunay, de Staël, Kupka, Mondrian, Soulages, Hartung, Balthus, etc. « Si l’art contemporain me touche, c’est à cause de cette recherche crispée et fascinante du nouveau et de l’inconnu ». Jérémie Gallon ajoute : « Pompidou cherche dans la création artistique les clés de compréhension du présent mais aussi de l’avenir ». Sa vision politique intègre aussi ses goûts esthétiques, au grand dam des élites culturelles de gauche qui n’apprécient pas du tout cette concurrence.
Intemporelles ses qualités humaines et sa force intérieure. Petit provincial sans relations, et snobé par les jeunes Parisiens de son âge, il s’est libéré d’un seul coup de ses complexes d’infériorité lorsqu’il manqua d’une place seulement l’entrée à Normale Sup à son premier concours. Il comprit alors qu’il n’avait rien à envier aux jeunes gens bénis des dieux qui l’entouraient. Il s’est fait lui-même, par des tournants décisifs pris au bon moment, sans perdre son temps à s’immiscer dans les réseaux de relations et les cénacles politiques. Et il est allé beaucoup plus qu’un Lucien de Rubempré.
C’est par un camarade de Normale Sup qu’il a su que de Gaulle à la Libération cherchait à étoffer son cabinet personnel. Ne se voyant pas rester toute sa vie professeur de lycée, il s’est présenté aussitôt. Le Général ne se trompe pas sur sa puissance d’intelligence et de travail : il lui confie rapidement des missions de confiance. En 1954, après 10 ans à son cabinet, de Gaulle lui offre une photographie qu’il dédicace ainsi : « A Georges Pompidou, mon collaborateur depuis dix ans, mon compagnon, mon ami pour toujours ».
Il passe ensuite les plus agréables années de sa vie à la Banque Rothchid. Sa clairvoyance et son esprit de synthèse lui offrent une grande réussite sociale et professionnelle (qui lui permet d’enrichir sa collection sans lui permettre toutefois d’égaler celles des grands magnats de l’industrie) en lui laissant l’occasion de nombreuses escapades touristiques et culturelles avec sa femme Claude, qui n‘a jamais aimé que son mari se fasse happer par la politique.
Cela n’aura qu’un temps : de Gaulle le rappelle à son cabinet lorsqu’il revient au pouvoir. Pompidou joue un rôle essentiel pour préparer les accords de paix avec l’Algérie. Il rejoint à nouveau pour une courte période la Banque Rothschild mais ne peut qu’accepter en 1961 la demande du général d’être son Premier ministre en remplacement de Michel Debré. Claude Pompidou détestera Matignon où elle n’observe que « jalousie et mensonges, petites intrigues et querelles d’intérêt personnel. »
Pompidou n’avait que trop conscience des sacrifices que son destin politique imposait à sa femme. Il fut effondré lorsque l’affaire Markovic, montée de toute pièce par un clan gaulliste qui l’avait toujours méprisé et tenu pour un intrus, chercha à détruire son couple et à lui faire abandonner la scène politique. Il crut un temps qu’elle pouvait pousser sa femme au suicide et ne l’a jamais pardonné. Il a jeté en novembre 1968 à de Gaulle après avoir exigé d’être reçu à l’Élysée : « Ni place Vendôme chez M. Capitant, ni à Matignon chez M. Couve de Murville, ni à l’Élysée, il n’y a eu la moindre réaction d’homme d’honneur ». Le chef de l’Etat, gêné aux entournures, en est resté sans voix.
Grand admirateur du général de Gaulle jusque-là, il n’a jamais perdu sa liberté de pensée ni d’action. Il a mis sa démission dans la balance pour lui arracher la grâce du général Jouhaux que le chef de l’Etat entendait faire exécuter. S’agissant du seul général putschiste né en Algérie, Pompidou ne voulait pas mettre en danger l’unité nationale en en faisant un martyr pour les pieds-noirs.
Intemporelles, quasi romaines, son sens du travail et sa philosophie de l’action.
Il connait mieux les dossiers inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres que ceux qui les présentent. Il reprochera à Chaban-Delmas de ne pas assez travailler et de remplacer l’action, qui conduit souvent à l’impopularité, par la parole. « La nouvelle société », « le changement » et autres mots que son Premier ministre lance avec gourmandise sans même l’avoir prévenu auparavant, c’est pour lui un « langage bon pour les intellectuels parisiens qui ne savent pas reconnaitre une vache d’un taureau ». Il estime, écrit Jérémie Gallon, « qu’un homme d’Etat a la responsabilité de ne jamais confondre la parole et l’action ». La parole d’un politique, fût-il chef de l’Etat, n’est pas performative contrairement à celle du Créateur. Pompidou précise sa pensée dans « Le nœud gordien », son testament politique publié après sa mort : « lorsqu’on a la responsabilité de gouverner un peuple, on n’a pas le droit de le précipiter dans l’inconnu sous prétexte que c’est amusant de détruire et que ce qui viendrait ensuite pourrait être meilleur ». Il assume ce conservatisme de droite et reproche à Chaban-Delmas de se vouloir en même temps de droite et de gauche.
Intemporel le sens de la dignité qui a toujours prévalu chez lui. Sens de l’honneur sur le plan personnel, dignité des fonctions exercées, respect pour les références sociales et culturelles des Français de toutes origines qu’il rencontrait. Devenu par ses fonctions à la banque Rothschild un habitué de la haute société parisienne, il n’a jamais eu de réflexe de caste ou de jugement préconçu sur ses contemporains. Après son élection, il déclare « ce qui compte, c’est que mon mandat soit pour la France une période de sécurité et de rénovation, de bonheur et de dignité ». C’est à Georges Pompidou, qui a donné des consignes très strictes au préfet Grimaud, qu’on doit l’absence de mort dans les émeutes de mai 1968. Il déclarera lui-même : « la France n’accepte pas qu’on tue des jeunes et moi-même ne pouvais en supporter l’idée ».
Moderniser ne signifiait pas pour lui s’absorber dans la mondialisation. Il a renforcé les groupes industriels français en ouvrant une série de fusions. Il a fortement soutenu l’enseignement technique pour fournir à l’industrie une main d’œuvre qualifiée. Il a mis en place l’actionnariat salarié et la négociation collective (autre domaine développé par Bernard Esambert) comme instrument de changement social. Pour lui, la modernisation de la France n’était tenable que si on respectait la dignité des hommes (ce qui sera oublié lors de la grande mondialisation mitterrandienne quinze ans plus tard). Il a créé en 1971 le premier ministère de l’Environnement de la Cinquième République avec à sa tête un normalien agrégé de lettres, Robert Poujade.
La tragédie n’est pas absente de sa vie. L’affaire Markovic lui a révélé la concentration de haine destructrice dont la politique est capable.
La maladie, une forme de cancer du sang, cruelle, douloureuse, l’a transformé en spectre de lui-même partir de fin 1972. Mais elle ne l’a pas empêché de prendre des décisions dont les effets se font encore sentir comme le lancement du premier plan nucléaire civil français (prévoyant la construction de treize centrales nucléaires), l’actionnariat des salariés dans le secteur privé, la construction de la ligne TGV Paris-Lyon ou les travaux préparatoires de la conférence d’Helsinki.
Laissons la parole à Jérémie Gallon pour terminer cette recension : « par son épaisseur intellectuelle et humaine, son autorité morale et son authenticité, il a laissé une trace unique dans notre histoire(...). Jamais il ne fut pris en défaut d’humanité ».

Ajouter un commentaire